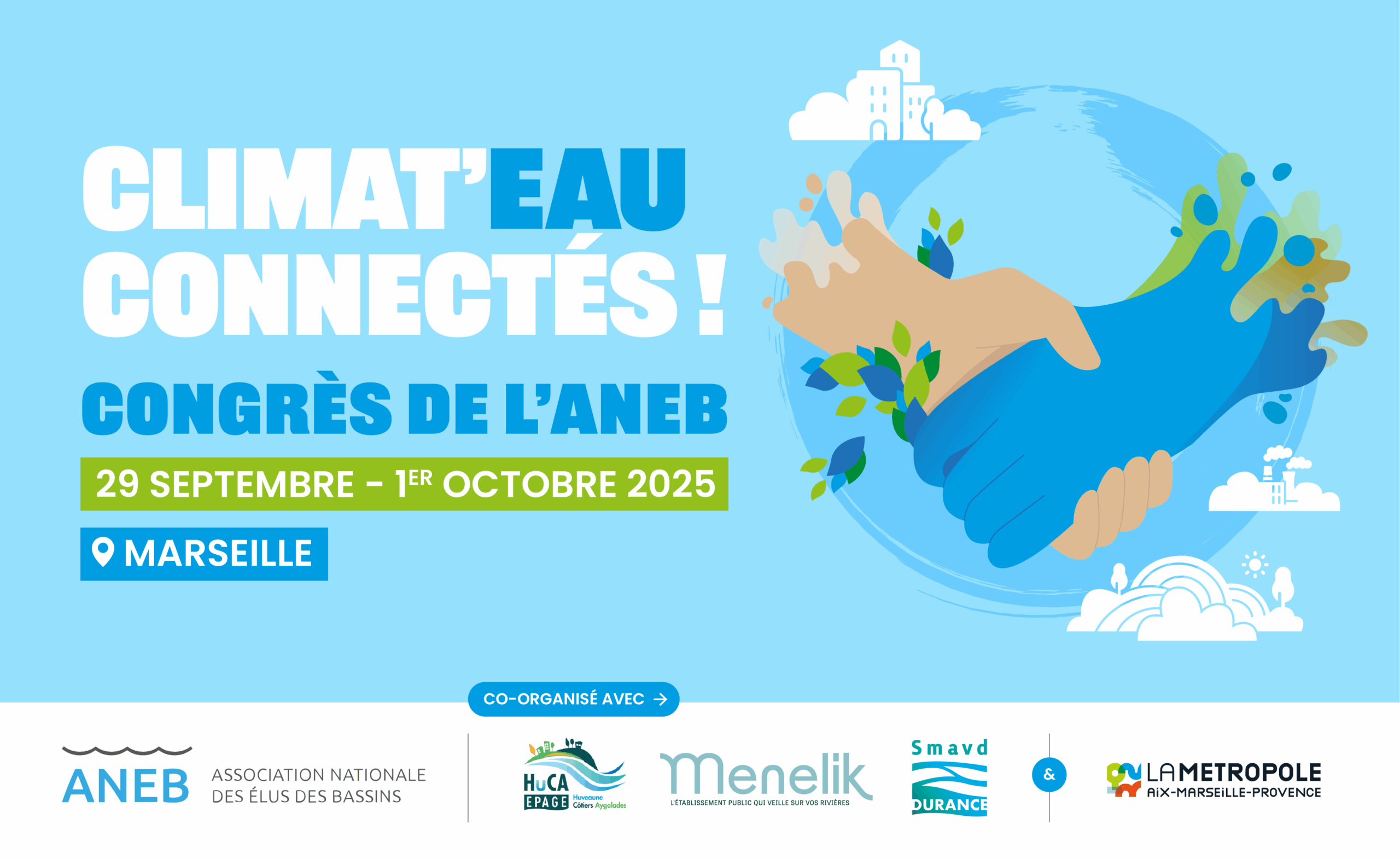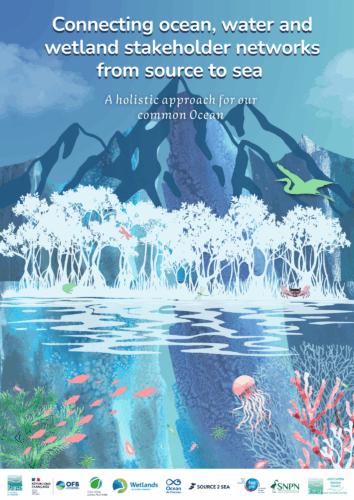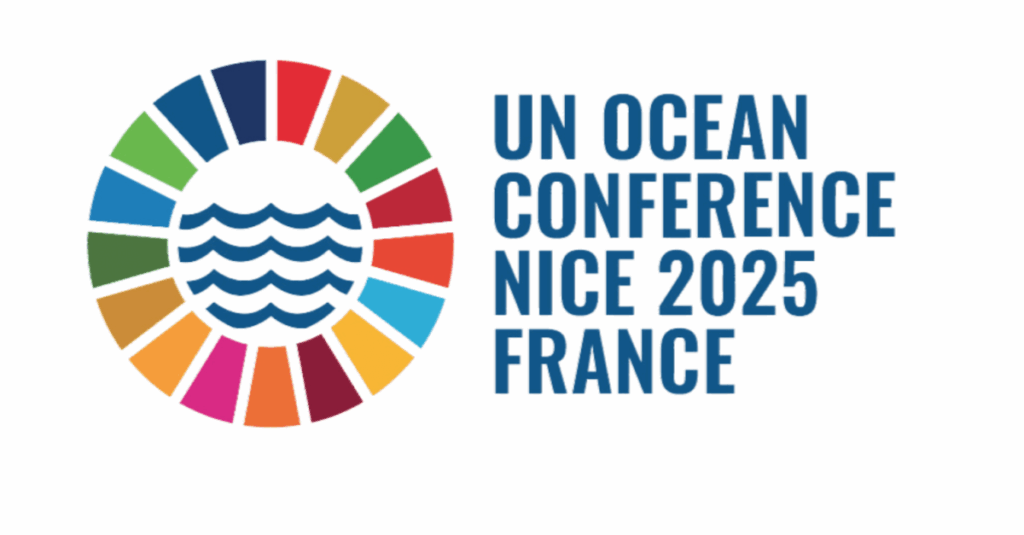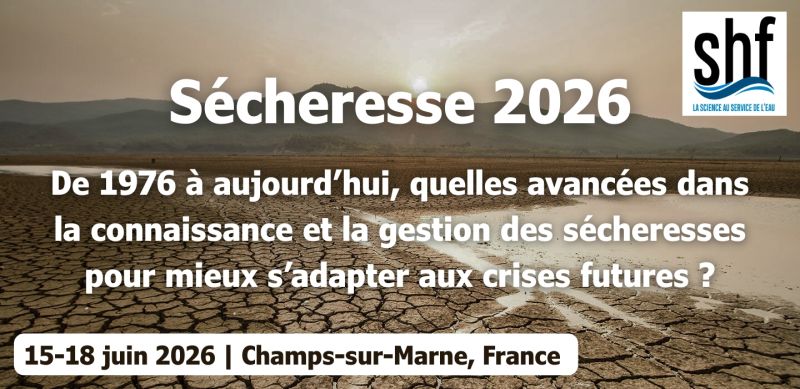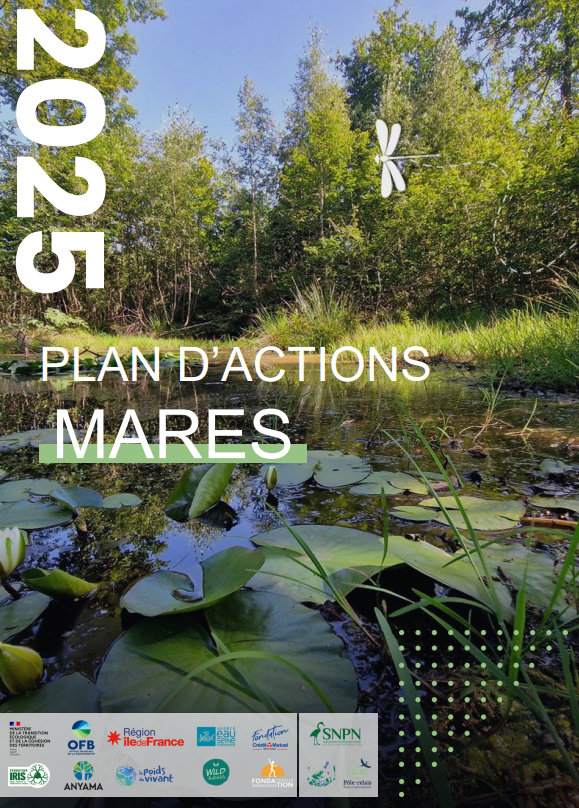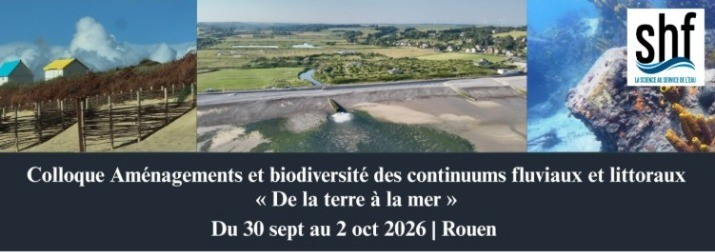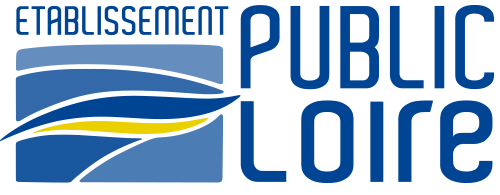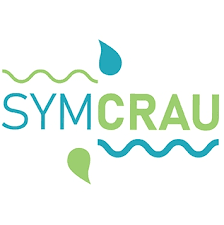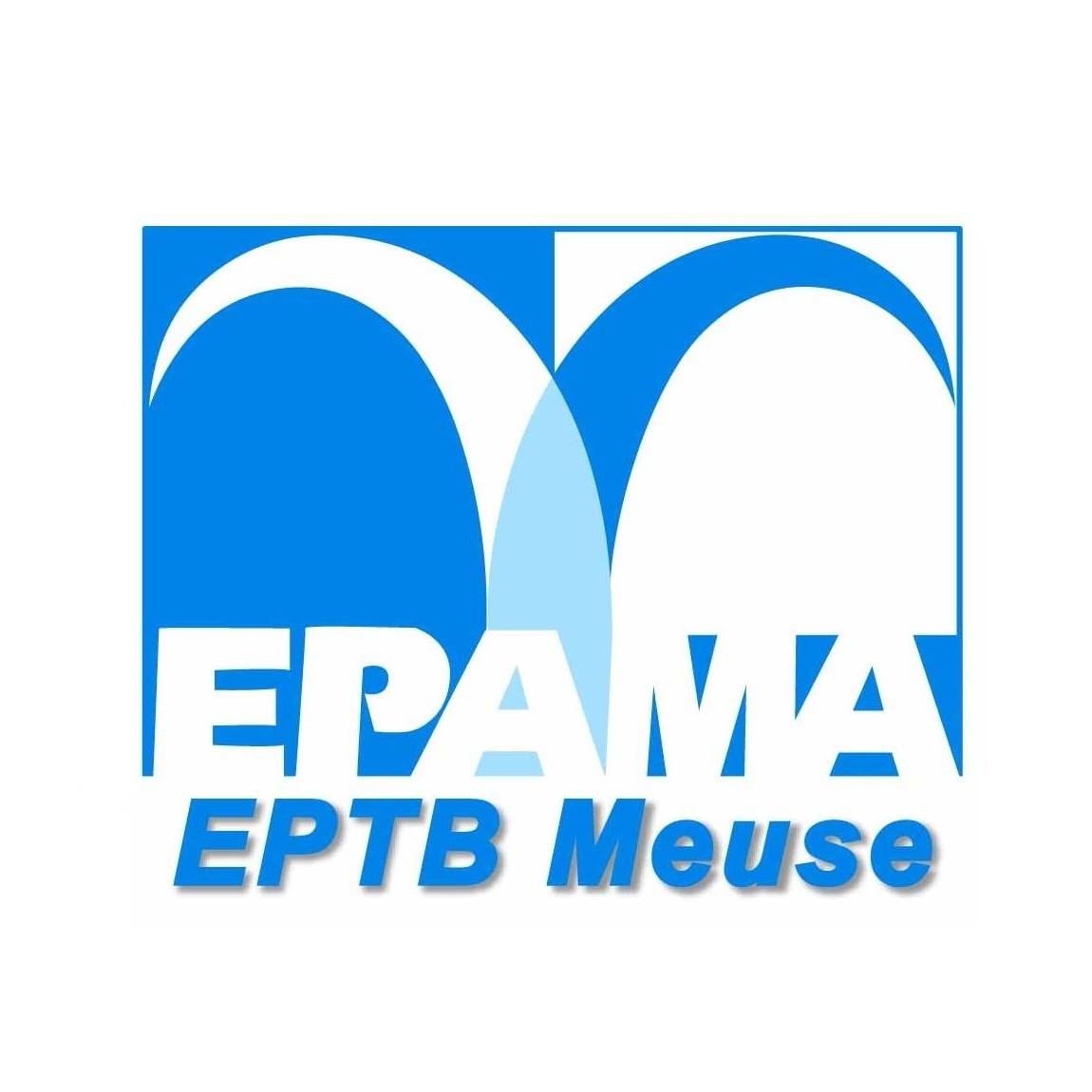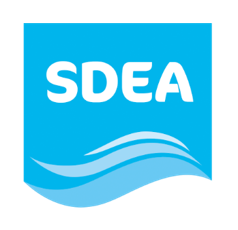Le compte-rendu nous sera adressé d’ici la semaine prochaine, pour prendre en compte les échanges en séance. La prochaine réunion, associant les experts (cf ci-dessous) se tiendra fin juin-début juillet.
Composition du COPIL national
Parlementaires
- Denise SAINT-PE, sénatrice des Pyrénées Atlantiques
- Dominique POTIER, député de la Meurthe-et-Moselle
- Pierre CAZENEUVE, député des Hauts-de-Seine
- Charles FOURNIER, député d’Indre et Loire
- Marta de CIDRAC, sénatrice des Yvelines
Elus locaux
- ANEB : Bruno FOREL, Président
- Intercommunalités de France : Régis BLANQUET, Vice-Président
- FNCCR : Hervé PAUL, Vice-Président
- FPEE : Estelle GRELIER, Présidente
Délégué Interministériel à la gestion de l’eau en agriculture
Comités de Bassin et Comité de l’eau et de la biodiversité
- Audrey BARDOT, Présidente du Comité de bassin Rhin-Meuse
- Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO, présidente du Comité de la biodiversité de Guadeloupe
Conseil National de l’Eau
Mandat
– En amont des conférences territoriales par bassin, qui doivent se tenir entre juin et octobre, le COPIL valide les données d’entrée, détermine la liste des questions soumises aux débats, fixe le format de restitution des Débats et approuve la nomination des experts thématiques.
– Il est informé par chaque bassin des modalités d’organisation des conférences
– Lui seront présentées les synthèses et analyses objectives des débats (synthèses nationales de débats et production des avis des experts thématiques à l’automne)
– Il propose les pistes de travail nationales.
L’avis du CNE sera rendu en décembre, et la transmission au Premier Ministre des pistes de travail identifiées par le comité de pilotage sera faire à l’hiver.
Les experts thématiques
Rôle : apport d’éléments de mise en perspective et de questionnement, présentation au COPIL d’une synthèse et analyse objective des débats dans les bassins par thématique (post-conférences). Ils sont assistés dans leurs tâches par les administrations centrales.
- Partage de la ressource : Agences de l’Eau – Chambre d’agriculture / Ministère de la Transition écologique-DGALN
- Réduction des pollutions : AMORCE / Ministère de la Santé-DGS
- Gouvernance : ANEB et FNCCR / Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation – DGCL
- Financement et prix de l’eau : Cercle Français de l’Eau / Ministère de l’Economie et des finances – DGT
- Gestion des risques (inondations et sécheresses) : INRAE et CEPRI / Ministère de la Transition écologique – DGPR et DGALN
- Accompagnement des collectivités compétentes : Banque des Territoire, Agence de l’eau / Ministère de la Transition écologique – DGALN
- Mobilisation du Grand Public : OFB / Ministère de la Transition écologique – CGDD
Données d’entrée et questions
Une première liste a été présentée lors du COPIL, et chaque membre du COPIL s’est exprimé.
Le Compte-rendu nous sera transmis d’ici la semaine prochaine intégrant les apports de séance, qui ont été nombreux.
De manière générale, il a été indiqué que nous avons besoin d’un cadre de débat clair. Le spectre de travail doit être recentré. Il faut chercher les « angles morts » et ne pas faire de l’entre-soi.
Cibler sur une opérationnalité des décisions.
Attention à ne pas doublonner avec des travaux déjà réalisés ou en cours, comme notamment les préparation des futurs SDAGE.
Intervention de la Ministre
- La ressource en eau est sous tension, et elle devient de plus en plus régalienne.
- Nous ne sommes plus résilients et les constats sont alarmants : cycles de « pas assez d’eau » et de « trop d’eau » qui n’arrivent pas à réalimenter le système.
- Pollutions stockées qui s’accumulent, fermeture de captages ; tensions sur l’approvisionnement en eau (Outre-mer mais aussi Pyrénées orientales (climat semi-désertique) avec conséquences immédiates sur l’économie notamment agriculteur.
- Il faut trouver des solutions sur les territoires, au regard des spécificités de chaque Bassin :
- fédérer les acteurs locaux autour d’un diagnostic partagé,
- projet partagé de solutions.
- On veut pour que ça marche s’appuyer sur vous (ne pas partir de rien, ne pas réinventer la poudre), attachement aux Bassins, à leur financement et à leur gouvernance (Agences de bassin, Comités de bassin) : modèle envié, copié, il marche bien ! On peut toujours faire mieux, mais globalement ça fonctionne. Donner un nouvel élan pour les prochaines 60 ans (pas évident par rapport au mur d’investissement, qui peuvent créer des dissensus sur les territoires).
- Conférence au niveau des bassins de juin à octobre, co-présidence CB/CEB et Préfet de bassin : décembre conclusion par la ministre ; examen projet de finance à voir si cela semble nécessaire ; articulation avec les COP territoriales, en subsidiarité : communication fluide entre les 2 instances, le bassin fera la synthèse pour le national. Analyse des remontées entre septembre et décembre par le COPIL et les experts.
- Données d’entrées : propositions de données nationales et territoriales sur la table, à compléter si nécessaire.
- Livrables et grandes questions : Recenser les actions prioritaires à mettre en place à l’échelle locale et nationale, porter au niveau européen la position de la France (dans un contexte de tension financière) ; éventuellement identifier les freins. A intégrer dans les prochains SDAGE.
- Doctrine ouvrages hydrauliques ; complément plan eau ; PPE pour vision transpartisane ; redevance pour pollution diffuse : point de blocage, quid ?
- Souhait d’un temps grand public, même si on sait que c’est compliqué dans les délais fixés : penser la communication, PQR, etc.
- Souhaite qu’au moins un livrable soit consacré aux décisions « sans regret » à déployer dès que possible sur tous les territoires.
Principales expressions lors des échanges
- Approche prix de l’eau dans la consommation des ménages etc ; approche sociologique est un point important (prix de l’eau péréquation).
- Périmètre de captage : voir les surfaces, et mettre au regard de l’espace agricole / mouvement du foncier et importance de la maitrise du foncier.
- Souveraineté industrielle en matière d’approvisionnement en eau, etc.
- VNF : 70% de l’eau utilisée sur notre territoire en volume ! (Ministre : le voir comme un endroit permanent le stockage).
- Cohérence avec les autres politiques publiques : agricoles, aménagement/ZAN, etc.
- Engagement politique plus fort à avoir : à l’époque, 2% de PIB pour approvisionner en eau : et nous ?
- Représentant des industries à avoir : c’est clé aujourd’hui ! ils regardent le prix de l’NRJ et la disponibilité en eau !
- Beaucoup de solutions existantes, etc : les mettre en lumière.
- Mettre la quantité et la qualité au même niveau de priorité.
- Pollueur payeur, REP, jusqu’où : qu’on sache qui paie pour qui etc.
- Mur d’investissement, on ne sait pas si on y arrivera.
- Le prix de l’eau est un vrai débat : n’est pas le plus cher, à mettre au regard d’un coût de service : le moins cher possible n’est pas la bonne pratique. Modèle de coopération entre public et privé qui n’est plus autoporteur, il ne tient plus avec la sobriété hydrique.
- La gouvernance est au cœur des solutions : la France est un modèle d’organisation par Bassin : le redire et le réaffirmer ! Mais il faut aussi à une échelle infra plus opérationnelle régler l’ensemble des problèmes de l’eau en transversalité : la question de l’eau touche de nombreux domaines (industriels, agriculture, etc) mais il faut intégrer dans les solutions que la ressource vient d’un milieu naturel global qui a besoin qu’on lui laisse une partie de l’eau. Proposer des solutions d’organisation pour rendre notre action globale plus efficiente, plus sobre, plus efficace. Il faut un lieu où l’on puisse être en capacité de gérer ensemble, lier les compétences, articuler les moyens entre eux.
- Pas uniquement le prix de l’eau à considérer mais le prix de la politique de l’eau dans son ensemble. Introduire aussi les services rendus : l’ensemble des politiques transversales qui permettent une résilience sont utiles à l’agriculture, à l’industrie, aux consommateurs : à travailler.
- Vers une évolution pour simplifier et donner de la cohérence, à travers la présence sur les territoires.
- Incapacité à compter ce qu’on consomme et ce qu’on prélève : data indispensables !
- Gouvernance : Il n’y a pas de modèle unique car sur les territoires les organisations se font à l’aulne des transferts d’eau.
- Appropriation par le grand public : attention aux médias ! Le discours d’une capacité technique à traiter l’eau quelque soient les pollutions ne doit pas être entretenu.
- Financement : les prêts sont utiles mais ne sont pas suffisants.
- Pour le grand public : il nous faut des documents simples et pédagogiques : pas facile mais indispensable / clips publicité Agence de l’eau à la télé : ludique, simple, précis, concret : s’inspirer de cela !
- Coût de l’inaction à mettre en avant ! sans eau on ne peut rien faire, complétement transversal.
- Risques d’une nouvelle loi : dogmatisme et brutalité des débats. Les décisions doivent se prendre au niveau local.
- Eau = enjeu majeur pour les prochaines années / dépasse le PCE et GCE : questions de souveraineté, développement économique, … cap clair, vision claire et surtout courage politique ! peut-être plus important même que le financement !
- Le Gouvernement doit aller au bout du sujet, en mettant en avant la nécessité de solutions locales, concrètes et non pas nationales.
- Le sujet du financement du grand cycle de l’eau est indispensable.
- Notion de réciprocité : plutôt financer une production française qu’étrangère dans nos investissements.
- Evaluation de notre incapacité à prendre des décisions juridiques.