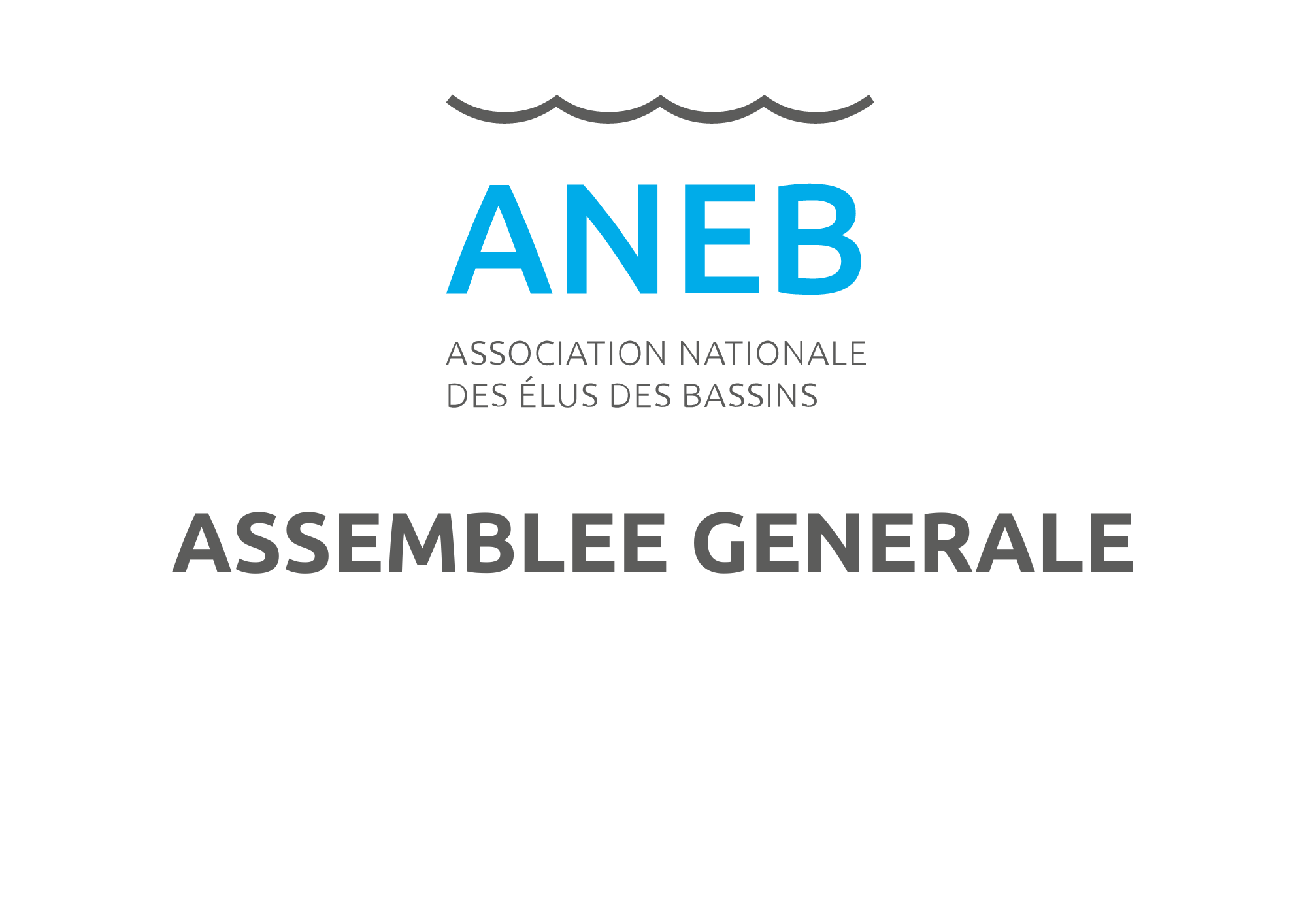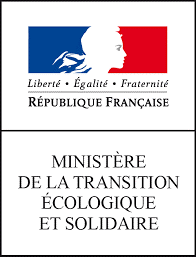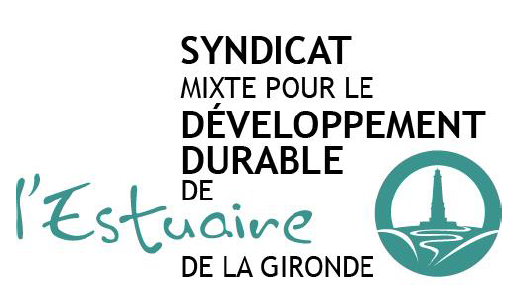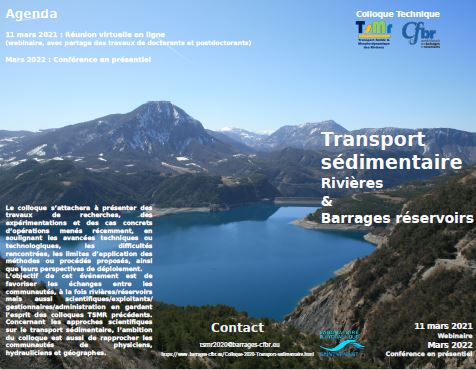Contexte
Chenalisation, endiguement, couverture intégrale, bétonisation… les cours d’eau ont subi des aménagements intensifs par la main de l’Homme depuis des siècles. Ces transformations du milieu naturel vers un milieu « contrôlé » ont pour origine l’installation des activités anthropiques à proximité des cours d’eau. Les rivières ont longtemps été considérées comme l’exutoire des eaux polluées, une force motrice facilement mobilisable mais aussi une gêne pour le développement. Leur dynamique naturelle a été entravée, réduisant ainsi leur rôle écologique. Dans certains cas, les dysfonctionnements sont tellement importants qu’ils accroissent également les risques.
Un changement de paradigme voit le jour depuis près d’une décennie : les villes retissent des liens avec leurs cours d’eau. Ceux-ci sont remis à ciel ouvert, restaurés, renaturés et valorisés.
Les gestionnaires de cours d’eau doivent ainsi élargir leur champ d’intervention à un secteur d’influence, espace plus large que le seul espace cours d’eau.
Et si la maîtrise du risque reste bien souvent la porte d’entrée d’opérations de restauration, il s’agit bien de projets multithématiques qui offrent de réelles opportunités pour répondre à des enjeux sociétaux, économiques et environnementaux.
Rappel des objectifs
- montrer l’intérêt d’une approche transversale et pluridisciplinaire dans la reconquête des cours d’eau en ville
- appréhender l’importance du facteur social dans la réussite d’un projet en milieu urbain
- découvrir des points clefs pour mener à bien ce type de projet
- informer sur les leviers existants pour favoriser ces projets et alerter sur les points de blocage.
Programmée initialement en présentiel fin 2020, elle prend la forme de visioconférences pour s’adapter au contexte sanitaire. Nous vous proposons de suivre les présentations en trois sessions :
- Visioconférence n°1, le mardi 27 avril de 9h30 à 11h30
- Visioconférence n°2, le mercredi 28 avril de 10h à 12h
- Visioconférence n°3, le mardi 4 mai de 14h à 16h30
Toutes les infos ici