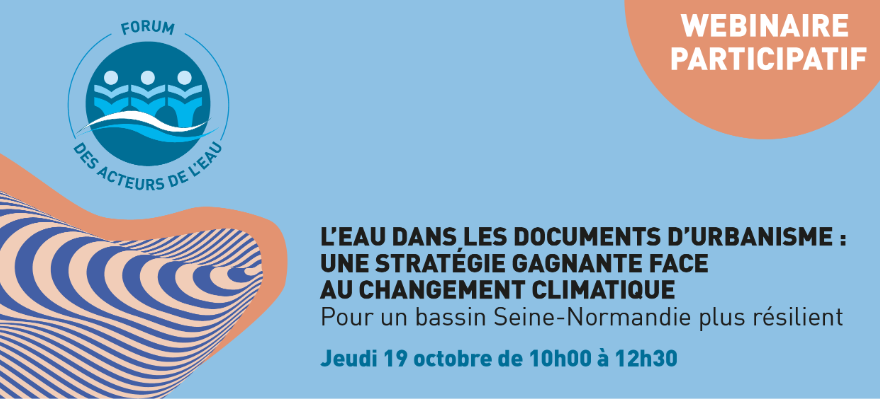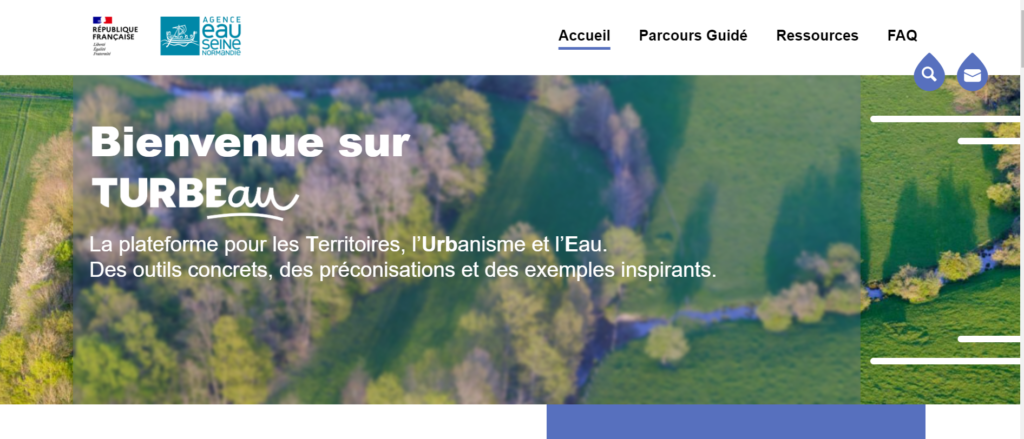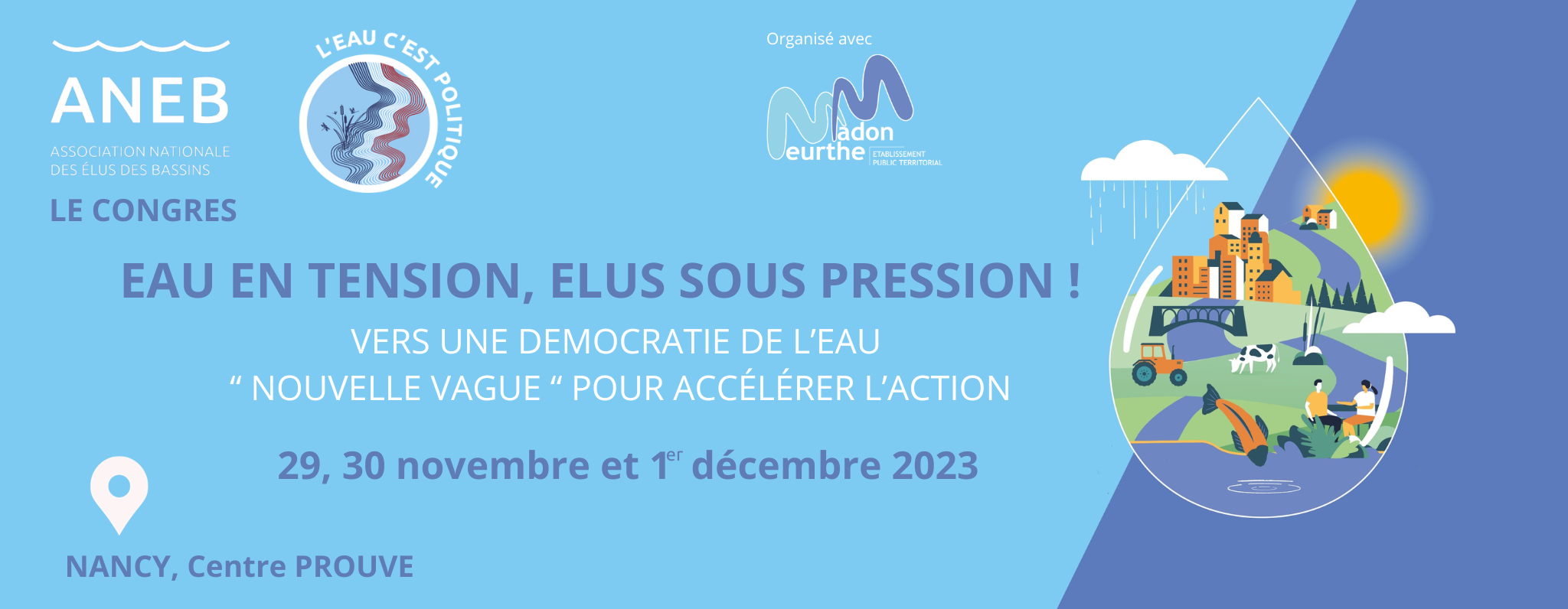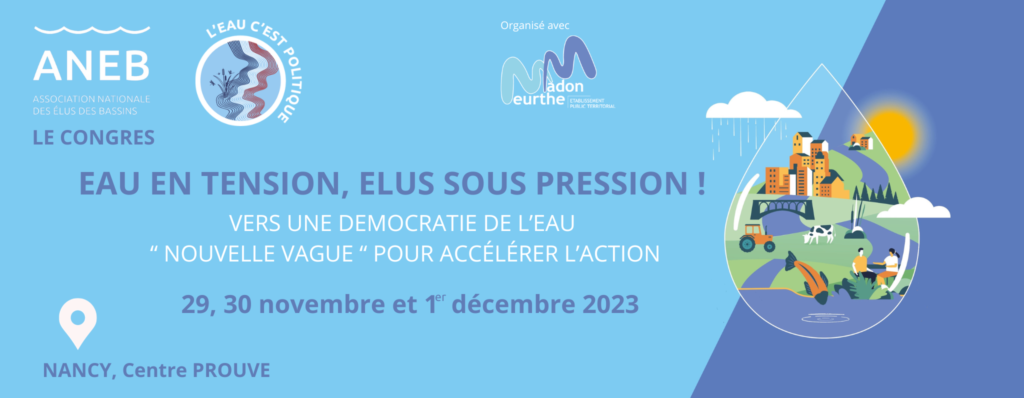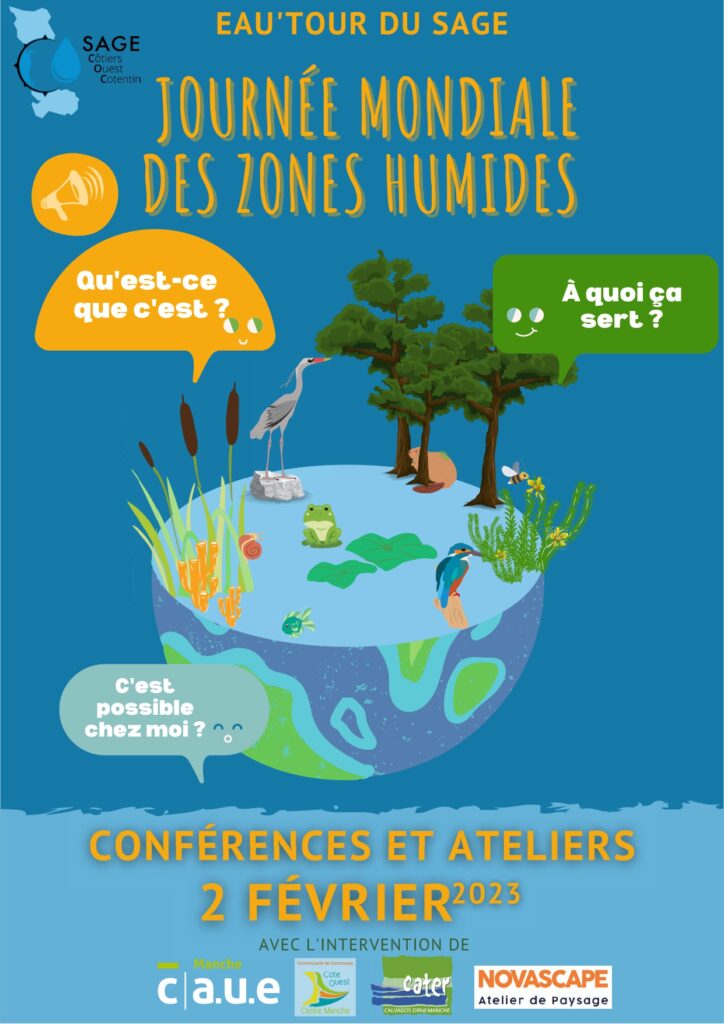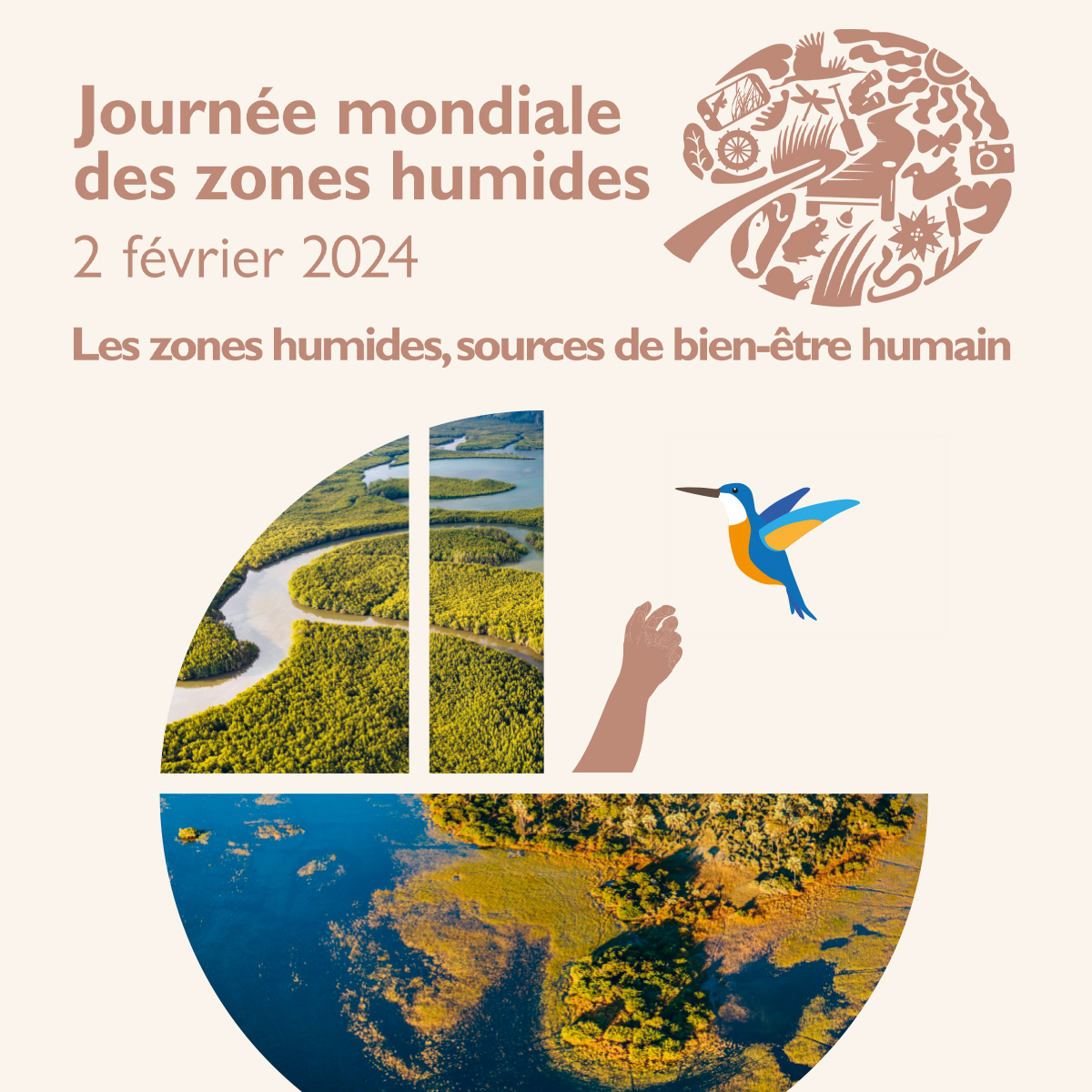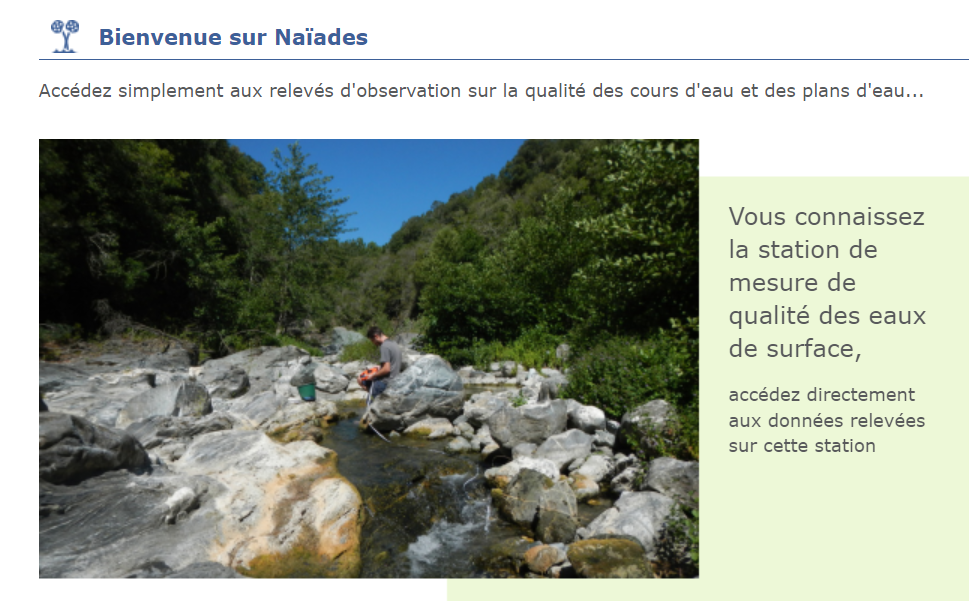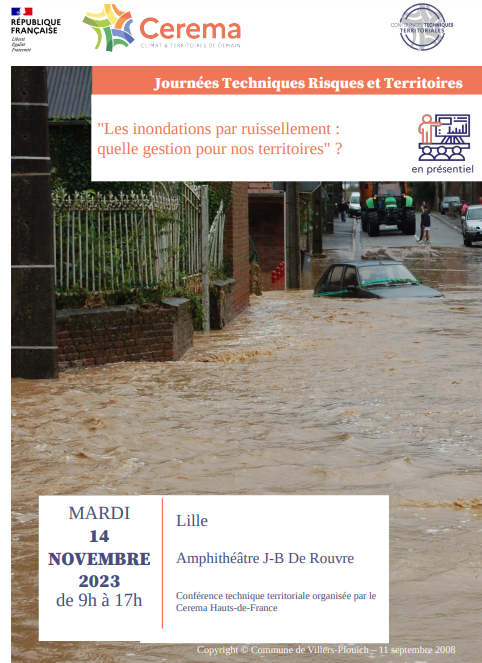L’eau devrait être vue comme une alliée plus qu’une contrainte pour l’aménagement du territoire : sa prise en compte améliore leur résilience face au changement climatique. Des solutions existent comme les îlots de fraîcheur, les trames vertes et bleues, la protection des sols, la gestion des eaux pluviales à la source…
Les documents d’urbanisme, qui fixent les règles d’utilisation des espaces sont le premier levier d’action pour cela : comment prendre en compte efficacement l’enjeu eau dans ces documents ? Quelles bonnes pratiques ?
Pour apporter des réponses, l’agence de l’eau Seine-Normandie organise, le jeudi 19 octobre 2023 de 10h à 12h30, un webinaire participatif dédié à l’intégration des enjeux de l’eau dans les documents de planification.
PROGRAMME COMPLET sur le site de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
Introduction
Sandrine Rocard, Directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie et Amélie Renaud, Adjointe au directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme et des paysages au sein du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
3 tables rondes animées par la journaliste Emmanuelle Dancourt
Table ronde 1 : Comment rendre les villes plus résilientes face au changement climatique ?
- Christian Métairie, Président du SMBVB (Syndicat Mixte du bassin Versant de la Bièvre)
- Alexandre Nezeys, Chargé du plan baignade à l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, en cours de confirmation
- Stéphanie Stiernon, Adjointe déléguée à l’urbanisme et aux grands projets à la Ville de Douai
- Christophe Poupard, Directeur de la connaissance et de la planification de l’agence de l’eau Seine-Normandie
Table ronde 2 : Comment faire de l’eau un atout en zone rural ?
- Jean-Pierre Abel, Président du syndicat DEPART
- Thierry Convert, Vice-Président à l’eau et l’assainissement de l’Agglomération de Rambouillet Territoires
- Eric Bertrand, Vice-président développement durable et risques majeurs de l’Agglomération de la région de Compiègne
- Christophe Poupard, Directeur de la connaissance et de la planification de l’agence de l’eau Seine-Normandie
Table ronde 3 : Quels leviers pour un document d’urbanisme ambitieux ?
- Jean-Pierre Abel, Président du syndicat DEPART
- Christian Piel, Urbaniste et hydrologue
- Adeline Live, Adjointe à la cheffe de département planification et territoires de la DRIEAT
Une présentation de TURB’Eau, la nouvelle plateforme développée par l’agence de l’eau pour vous aider à mieux intégrer l’eau dans les documents d’urbanisme.