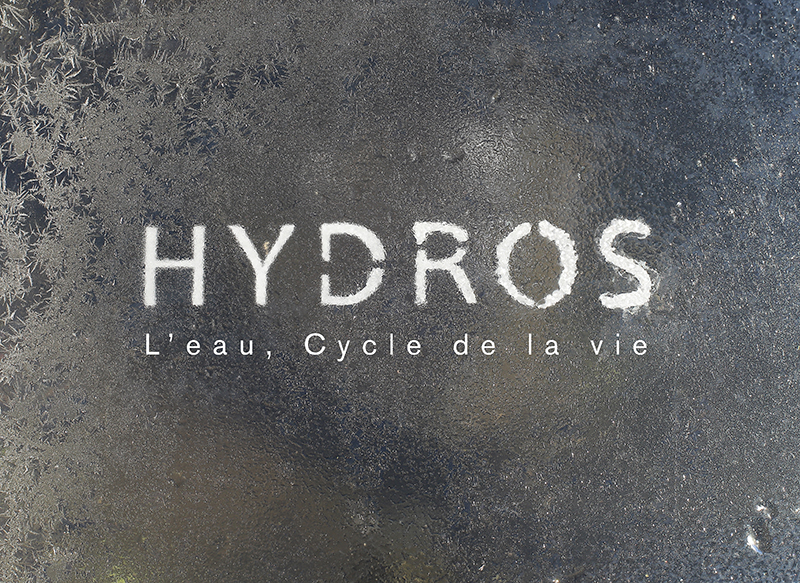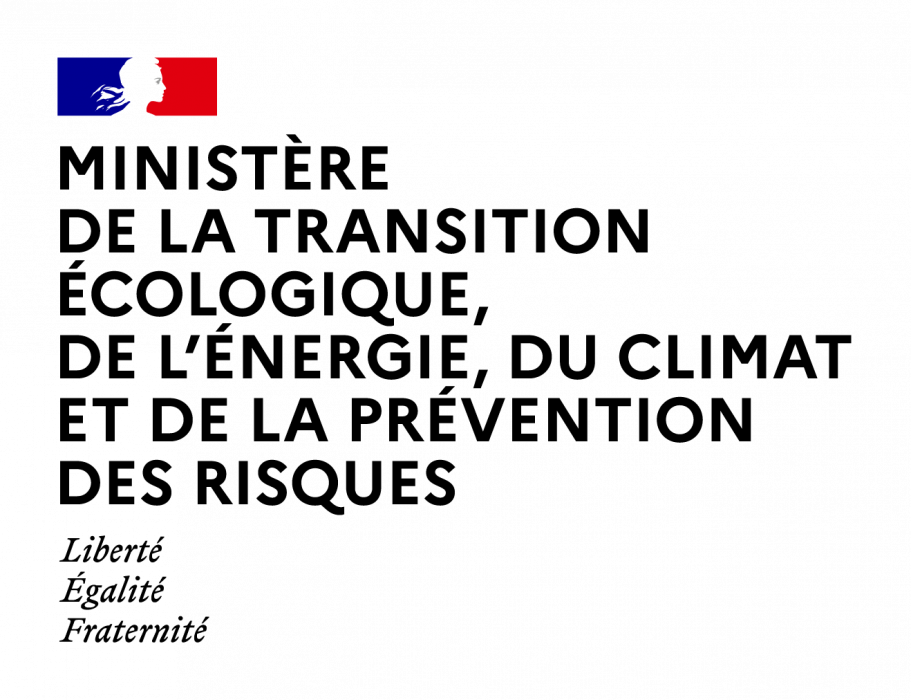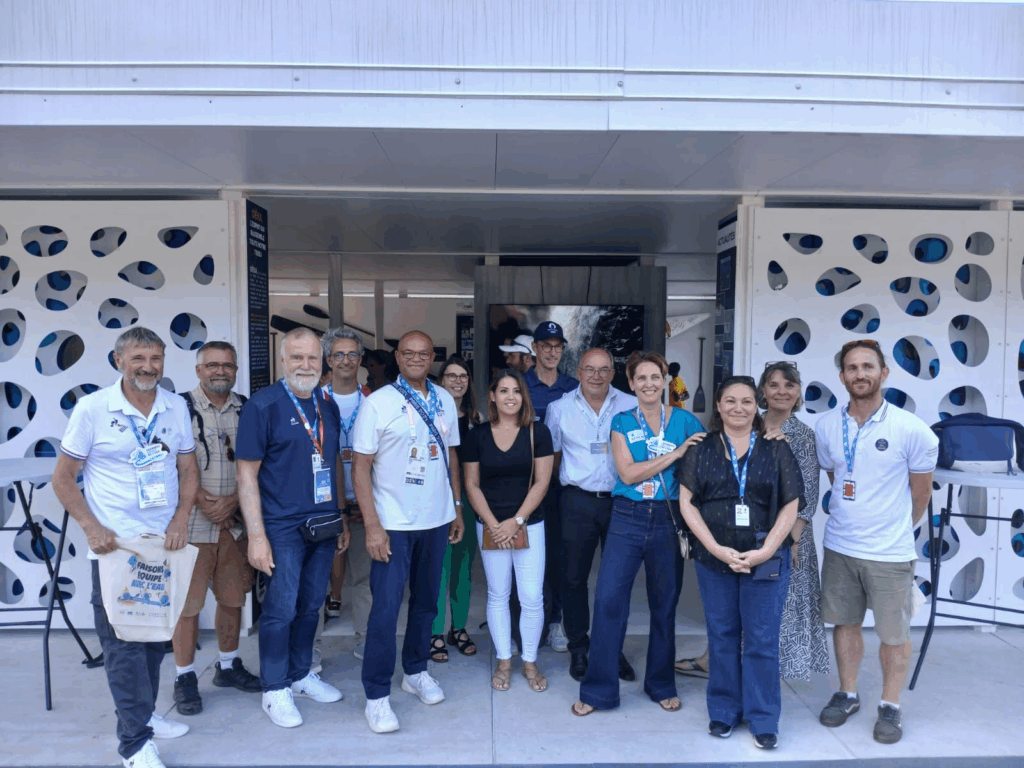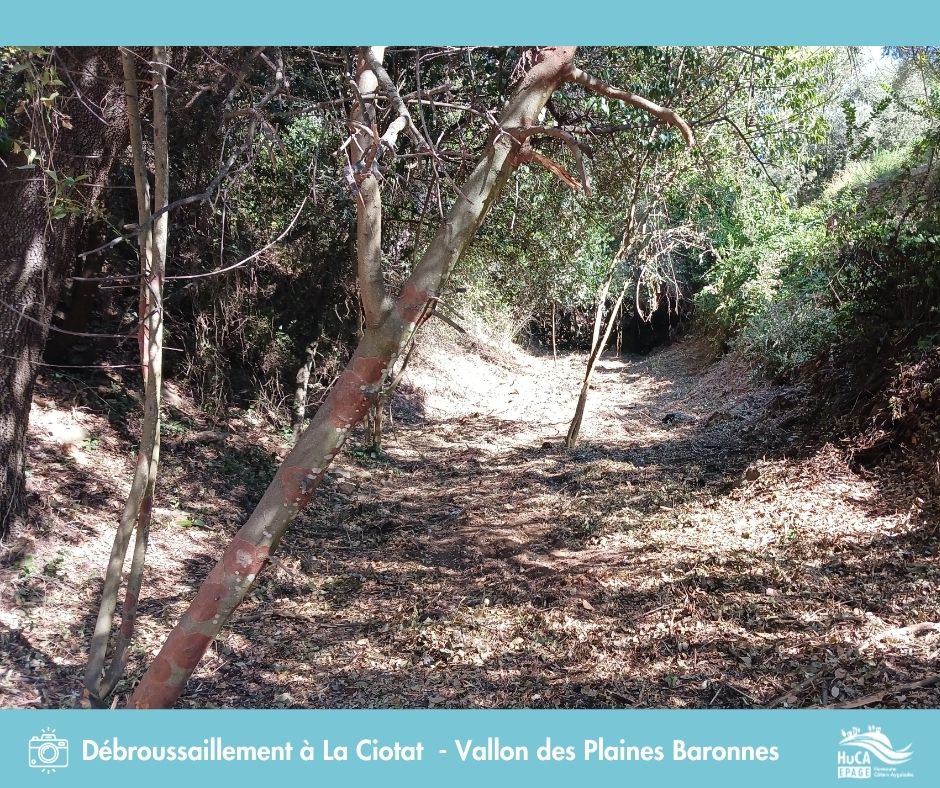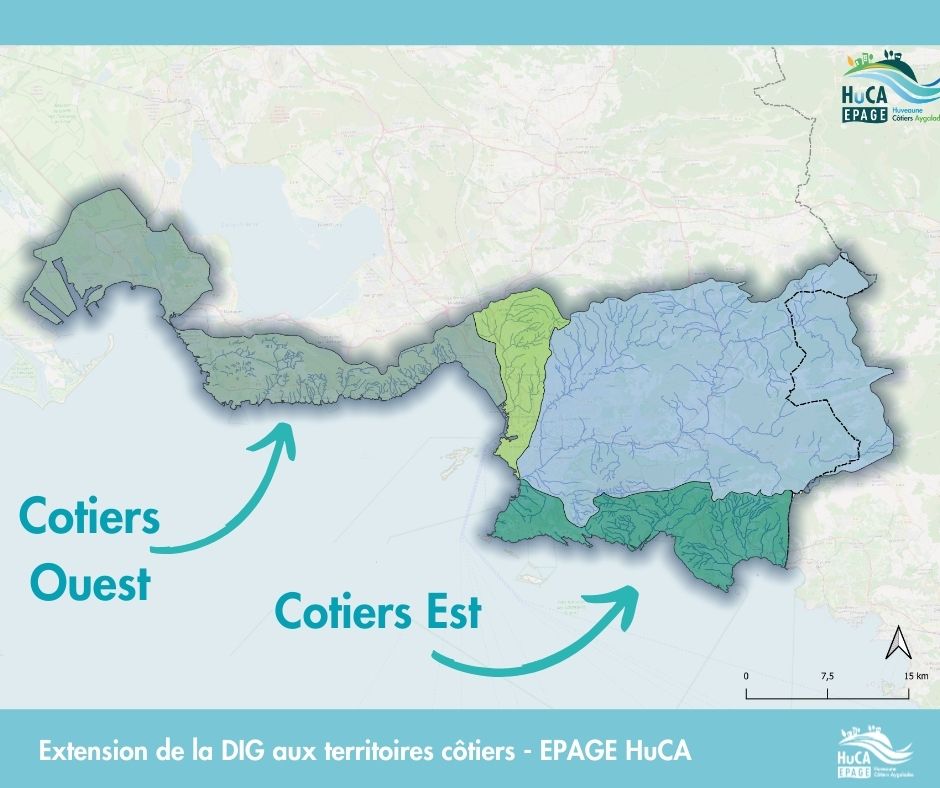LOCALISATION : Vienne, France
CONTRAT : CDI
PROFIL : Ingénierie
EXPÉRIENCE : > 1 an
DATE DE DÉBUT : Poste à pourvoir dès que possible
TYPE DE TÉLÉTRAVAIL : Télétravail partiel possible
Le poste
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité d’un chef de projet, le/la chargé(e) d’étude « zones humides » participera à la réalisation des études écologiques sur le volet “zones humides” :
• Délimitation et caractérisation des zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 et circulaires associées,
• Analyse des impacts sur les zones humides et application à la démarche ERC aux zones humides,
• Proposition et rédaction de mesures compensatoires en conformité avec les SDAGE (voir SAGE) associés,
• Evaluation des potentialités des zones de compensation,
• Analyse des fonctionnalités en application de la version 2 du guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides,
• Conseil et accompagnement des clients sur la thématique Zones Humides,
• Déplacements à prévoir dans le secteur géographique de l’agence concernée (Auvergne – Rhône-Alpes) et périphériques (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 à 5 en écologie (ou expérience significative dans le domaine de compétence souhaité), vous disposez de bases en fonctionnalités des zones humides.
Vous avez déjà travaillé sur de la délimitation des zones humides (critère pédologique a minima) ou avez des bases en pédologie.
Vous avez des notions en réglementation relative à la Loi sur l’Eau, en démarche ERC et en étude d’impact. Des notions en botanique et phytosociologie, des zones humides notamment, serait un plus.
Enfin, vous faites preuve de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles, êtes en maîtrise des logiciels de bureautique dont Excel notamment. Vous avez un véritable sens du travail en équipe.
Le poste requiert des déplacements réguliers sur le terrain, ainsi le permis B est exigé.
CONDITIONS ET AVANTAGES DU POSTE
• Être Ecosphérien, c’est bénéficier d’une rémunération attractive selon votre profil et expériences. Elle est composée d’un salaire fixe, d’un intéressement et de la participation aux résultats d’Ecosphère, ainsi que de primes (vacances, d’évaluation et exceptionnelles).
• Les Ecosphériens ont de nombreux avantages sociaux : RTT, titres Restaurant, télétravail, mutuelle prise en charge à 100%, l’annualisation du temps de travail, souplesse des horaires, des congés et absences, pas de travail imposé le week-end et jours fériés, participation aux transports publics, politique salariale incitative et dynamique.
• Vous serez accompagné dans votre évolution de carrière (accompagnement personnalisé, formations, prise de responsabilités, promotion régulière en fonction des performances, mobilité sur l’un de nos nombreux sites dans toute la France).
Cliquez ici pour plus d’informations.